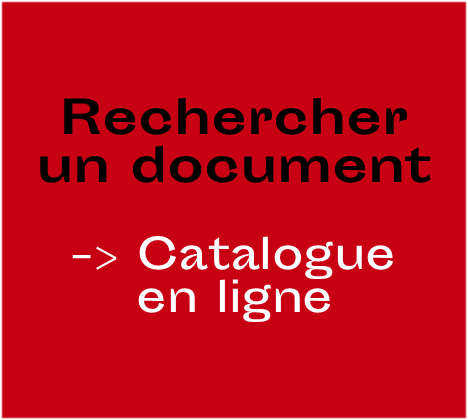- Catégorie
- Cycles de cours
 Cours à l'Université permanente (Nantes)
Cours à l'Université permanente (Nantes)
Christophe Patillon, animateur-chercheur au CHT, dispense des cours à l'Université permanente.
L'objectif de ces cours est de faire connaître la richesse de l’histoire sociale de la Loire-Atlantique et de l’Ouest en partant de luttes et d’événements marquants.
A noter : les cycles sont indépendants les uns des autres et aucune connaissance en histoire sociale n’est requise !
Ces cours sont ouverts à toutes et tous et ont lieu le lundi matin, de 10h à 12h, dans le bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes où se situe le CHT.
En 2025, les cycles sont les suivants :
- Femmes au travail : s’affirmer par la lutte (29 septembre, 6 et 13 octobre)
- Ouvriers, paysans et pêcheurs : les chemins de l’unité (24 novembre, 1er et 8 décembre)
- Le syndicat, voilà l’ennemi : résistances patronales (5, 12 et 19 janvier)
- Moments forts de l’histoire sociale de la Loire-Atlantique (26 janvier, 2 et 9 février)
Pour connaitre les tarifs, le calendrier et les modalités d'inscription, rendez-vous sur la page Inscriptions UP. Il est possible de s'inscrire toute l'année, jusqu'au début des cours du cycle.
L'Université Permanente est un service de Nantes Université dont les missions sont la diffusion des connaissances, le partage, l'échange et le lien social.